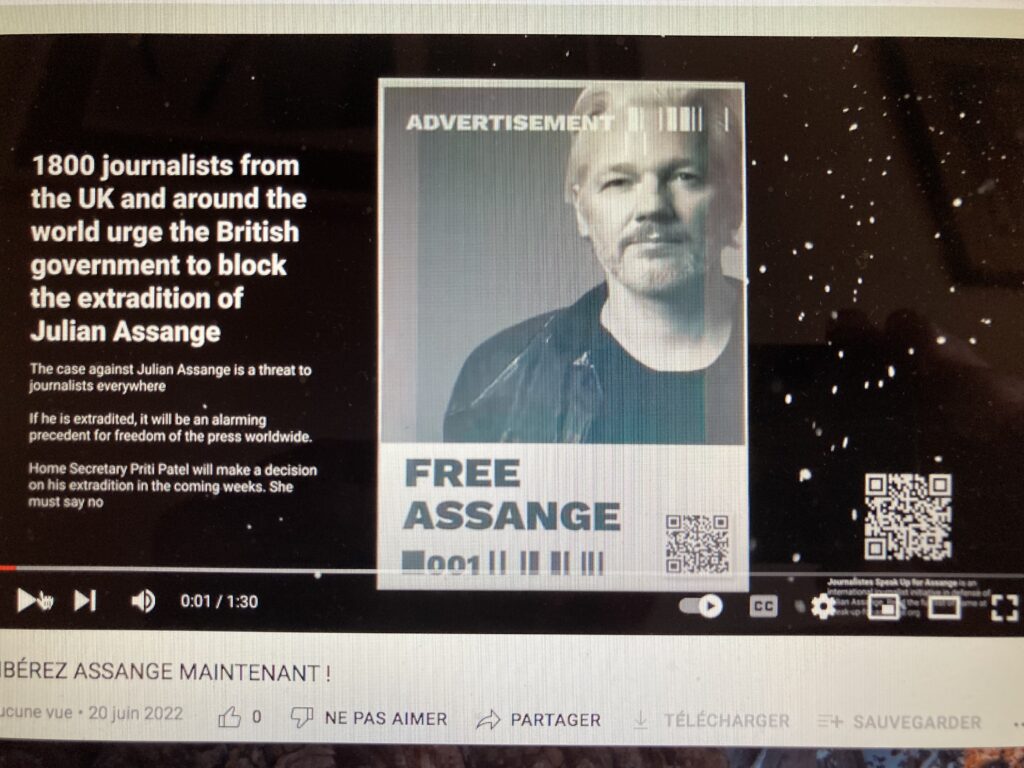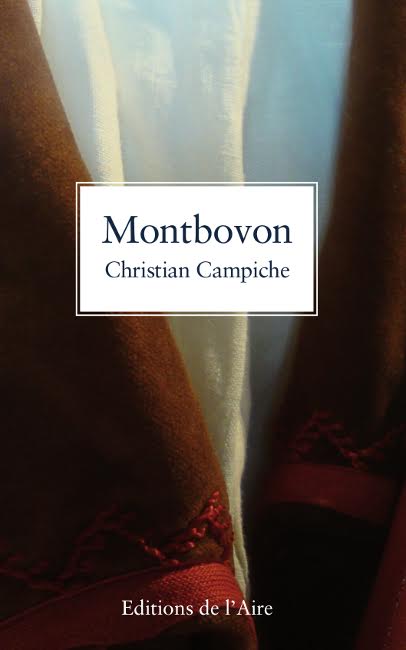Vingt hectares de vignoble entre garrigue et lagune dans la région rocailleuse des Corbières. Au loin, une colonie de flamants roses, la mer. Les sangliers attendent la nuit pour sortir du bosquet qui surplombe le blanc mas aux volets bleus. Le ciel du Languedoc se marie avec les coquelicots balayés par la tramontane. C’est près de Gruissan, au pied du massif de la Clape, que s’est installé Pierre Richard en 1986. Un petit paradis qui propose le Château Bel Evêque, un vin rouge et rosé, plusieurs fois primé.
PAR CHRISTIAN CAMPICHE
Le comédien en est très fier, à double titre. D’abord parce qu’il a transformé une vigne squelettique, moribonde, en un des meilleurs crus de la région. Ensuite, parce que sa production reste à dimension humaine. Contrairement à d’autres gens du spectacle, Pierre Richard ne collectionne pas les vignobles. Son sillon, il veut savoir où le creuser: 80 000 bouteilles par an, une récolte manuelle, il ne manque qu’un cheval pour labourer la terre. L’acteur y pense, d’ailleurs. Ses convictions l’y poussent.
Pierre Richard, la route qui mène à votre domicile n’est pas asphaltée. C’est votre manière à vous de lutter contre les dérèglements climatiques?
Pierre Richard: Absolument! On m’a proposé de l’asphalter, mais je ne veux pas. Ma préoccupation est d’ordre environnemental. Climatiquement, nous allons droit dans le mur. Cela fait deux décennies que l’on parle de prendre des mesures, et personne ne fait rien. Les articles que je lis sont terrifiants. Notre survie n’est plus une question de siècles, mais de quelques dizaines d’années. L’inconscience des personnes qui nous gouvernent m’affole. Mais que puis-je faire pour sauver la planète sinon éteindre l’électricité le soir, éviter de prendre des bains ou d’asphalter ma route? Sur le plan alimentaire, je pense qu’il faudrait manger «bio». Je le fais quand je peux, je me méfie de ce que l’on me donne au restaurant. Evidemment, c’est un peu facile de dire cela de ma part. Tout le monde n’en a pas les moyens.
Si vous aviez vingt ans aujourd’hui, dans quoi vous lanceriez-vous?
Peut-être irais-je chez Greenpeace ou dans une organisation similaire, oui. Je crois que ce serait la première des urgences.
L’acteur très connu que vous êtes se sent-il une responsabilité particulière dans la prise de conscience écologique?
Je n’ai pas une tête de gondole. Ma timidité l’explique peut-être mais je ne suis pas du genre à monter sur un podium. La seule fois de ma vie que j’ai fait un discours politique, c’était chez les Sahraouis, où je vais tous les ans. La manipulation des gens, ce n’est pas mon truc. J’ai un côté Don Quichotte, comme ça, mais en regard de toutes les injustices qu’il y a dans le monde, je me dis que je ne fais pas grand-chose. Il y a dix ans, et c’est mieux que rien, j’ai toutefois produit un film sur les Indiens Kogis de Colombie. Derniers représentants d’une civilisation précolombienne, ils sont au nombre de 12 000 et menacés de disparition..
Comment avez-vous épousé leur cause?
Je me suis toujours senti concerné par le problème des Indiens, jusqu’à ceux du Brésil. Je pense que nombre de tribus de race indienne auraient beaucoup à nous apprendre sur des choses que nous avons complètement perdues. J’avais entendu parler des Kogis grâce au géographe Eric Julien, qui a vécu dans cette communauté et ramasse de l’argent pour elle. J’ai d’abord lu huit lignes sur son action dans un journal. Puis je suis tombé sur lui par hasard dans un restaurant. A la table à côté, il y avait quelqu’un qui parlait des Kogis. C’était Eric Julien. Je me suis présenté, nous sommes devenus amis. Je suis devenu le parrain de son association, Tchendukua, et j’ai produit un documentaire qui relate le retour d’Eric Julien parmi les Kogis. Des retrouvailles très émouvantes. Les Kogis ont été chassés de leurs terres et refoulés sur les hauteurs. L’action de l’association a été d’acheter 20 à 30 hectares et de les remettre solennellement aux Kogis. L’association étant la propriétaire, il n’est plus possible de les chasser. Julien a eu beaucoup de mal à trouver un notaire. Tout le monde a peur là-bas.
Aujourd’hui, continuez-vous à soutenir financièrement les Kogis?
Oui. Je prépare un show à la fin de l’année. La recette de la soirée sera versée à l’association, car le territoire qui lui appartient s’agrandit. Il est à présent de 80 hectares. Mais la vigilance est de mise. Les Kogis font l’objet de menaces, voire de meurtres. Il y a deux ans, Henti, un métis ne parlant pas seulement le kogi mais aussi l’espagnol et qui était notre traducteur, a été assassiné. A mon avis, il a été tué par les paramilitaires. Entre ces derniers, l’armée gouvernementale, les FARC et les grands propriétaires blancs, il n’y a pas beaucoup de place pour les Kogis.
Etes-vous allé sur place?
Non, malheureusement. Au moment du tournage du documentaire, je souffrais d’une hernie discale. Par la suite, quand trois Kogis sont venus en France avec Eric Julien, je les ai invités chez moi. Ils ont débarqué dans leur tenue quotidienne. Sandales, pantalon en toile blanche, petit sac contenant une calebasse, cheveux noirs jusqu’aux épaules. Un jour, Eric les a emmenés du côté des Alpes où ils étaient conviés à rencontrer des scientifiques. Ceux-ci furent «scotchés» par leurs théories sur la vie et la mort, mais les Kogis sont revenus choqués. On les avait fait passer sous le tunnel du Mont-Blanc et, pour eux, faire un trou dans la montagne était un sacrilège.
Le respect de la nature…
Oui, la philosophie des Indiens est le respect de la nature. Or ce respect, nous ne l’avons plus. On pollue la ville, les rivières, les mers au nom de la croissance économique. Même au pays des lacs, le Canada, les Indiens ne pêchent plus. Pourquoi? Parce qu’il y a du mercure. Et pourquoi y a-t-il du mercure? A cause des chercheurs d’or. C’est dément: on bousille tout, on fout le camp et on laisse la merde.
Né Pierre Richard Maurice Charles Léopold Defays, vous êtes le fils d’un industriel du Nord de la France qui vous voyait reprendre l’entreprise familiale. D’où vous vient cette passion pour la nature?
J’ai un peu honte de le dire, mes quatre années les plus belles, je les ai vécues pendant la guerre dans l’Yonne, chez mon grand-père italien. Comme j’étais enfant, je n’avais pas conscience des horreurs de l’époque. Je vivais pieds nus, on pêchait des gardons, on posait des collets. Cela donnait un vrai sens à la pêche et à la chasse, car c’était pour manger. Je vivais comme Huckleberry Finn et cette vie de sauvage me plaisait vraiment.
Vous avez réalisé et produit, en 1987, un documentaire sur Che Guevara. Par sympathie particulière pour le régime cubain?
Non, pas besoin de faire un dessin sur la situation des Cubains. J’ai fait ce film à cause du personnage du Che, mais je dois dire que je n’ai eu aucun problème à le tourner. Il se trouve que l’acteur Pierre Richard est très connu à Cuba, ce que j’ignorais avant le tournage. La bonne surprise, là-bas, c’est que j’ai eu toutes les facilités. Avec le journaliste Jean Cormier, j’ai été sur les traces du Che, nous avons rencontré Granado, l’ami d’enfance du Che, sa fille Hildita et son petit-fils Canek, lesquels sont ensuite venus chez moi. J’ai connu également Korda, l’auteur de la photo mythique du Che qui a fait le tour du monde. Korda vivait dans une pauvreté extrême. Ayant eu le malheur de céder ses droits à un photographe italien, c’est ce dernier qui est devenu milliardaire à sa place.
Vous étiez un acteur également très populaire en Europe de l’Est. Comment l’expliquez-vous?
Cela remonte au temps du communisme, quand tous les pays du bloc soviétique interdisaient les films américains, les films politiques, d’amour ou de sexe. Les comédies, en revanche, étaient autorisées. Et quand Louis de Funès est mort, je suis resté tout seul. J’ai gagné par élimination.
Leonid Brejnev vous invitait à Moscou?
Non, je n’y suis jamais allé en ce temps-là. Mais, plus tard, j’ai appris que «La moutarde me monte au nez» avait fait 120 millions d’entrées. Faramineux! Quand je suis allé la première fois en URSS, j’ai vite réalisé l’étendue du phénomène: une voiture m’attendait en bas de l’avion, je n’ai pas eu besoin de passer la douane et on m’a donné quatre gardes du corps. Au Kazakhstan, les gens me jetaient des boîtes de caviar d’un kilo et demi dans la voiture…
Interview parue dans “La Liberté” du 18 mai 2009