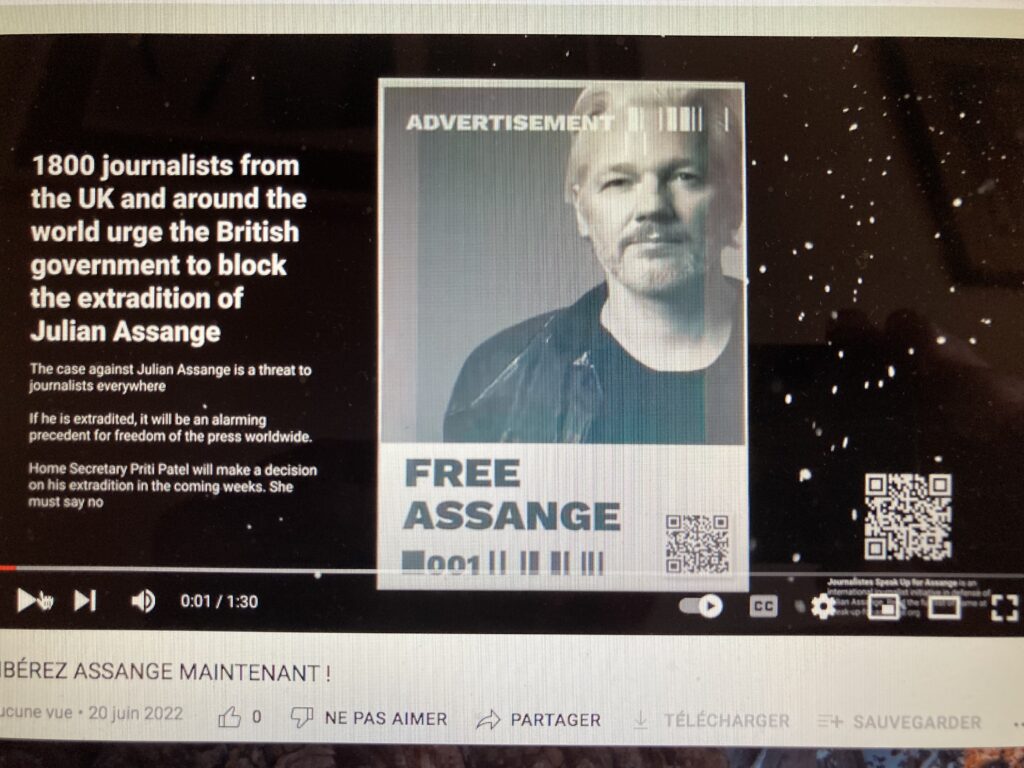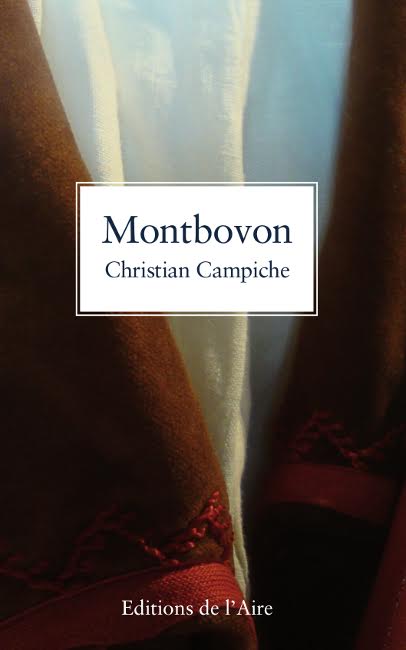En janvier 2004, UBS se voyait décerner la palme de la meilleure banque privée mondiale.
CHRISTIAN CAMPICHE
Le jugement flatteur émanait d’un magazine financier anglo-saxon prestigieux. UBS retournera-t-elle un jour sur le podium? Au vu des résultats affichés hier, le chemin risque d’être plus long que prévu.
D’abord parce que la banque n’a pas achevé sa cure d’amaigrissement. Sept mille emplois ont déjà été sacrifiés au cours des derniers mois en vue d’améliorer la rentabilité. Aidée par le rebond de la bourse, la base de fonds propres s’étoffe et la solvabilité commence à devenir enviable, permettant d’entrevoir la sortie du tunnel en 2010, mais les pertes demeurent encore deux fois supérieures aux attentes des analystes.
UBS devra ensuite regagner la confiance de la clientèle, et ce n’est pas le moindre des défis qu’elle aura à relever. Singulier est le contraste entre l’espoir alimenté par le redressement du secteur de la banque d’affaires et la déception qu’entraîne le retrait des fonds. Les sorties d’argent s’élèvent à 37 milliards, elles ont été particulièrement importantes aux Etats-Unis et, plus grave encore, sur le territoire indigène. UBS paie le traitement infligé à sa clientèle américaine, livrée au fisc de Washington. Le dommage, en termes d’image, est considérable. Il met en péril les marges.
Trop grand pour couler. Fort de l’adage financier, la Confédération et la BNS intervenaient massivement en 2008 pour sauver le colosse bancaire de la faillite. Une année après, l’opération est à moitié réussie. L’UBS n’a pas sombré corps et biens, elle n’a pas entraîné dans sa chute des pans entiers de l’économie suisse. Mais elle n’est pas tirée d’affaire pour autant.
Privée de sa réputation de banque hors pair, UBS n’est plus que l’ombre d’elle-même, son salut passe avant tout par une solution externe. Une fusion avec Credit Suisse, par exemple. Un concurrent qui flamboie pendant qu’UBS grille.
Commentaire paru dans “La Liberté” du 4 novembre 2009