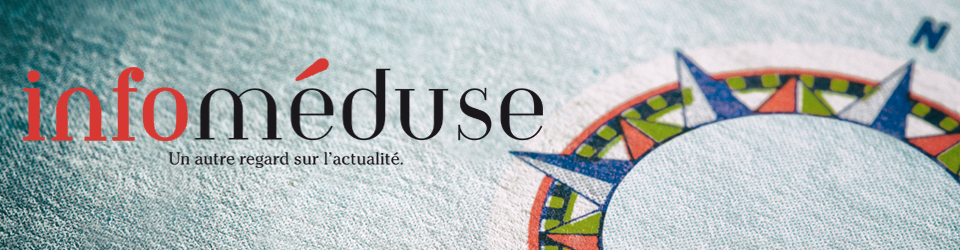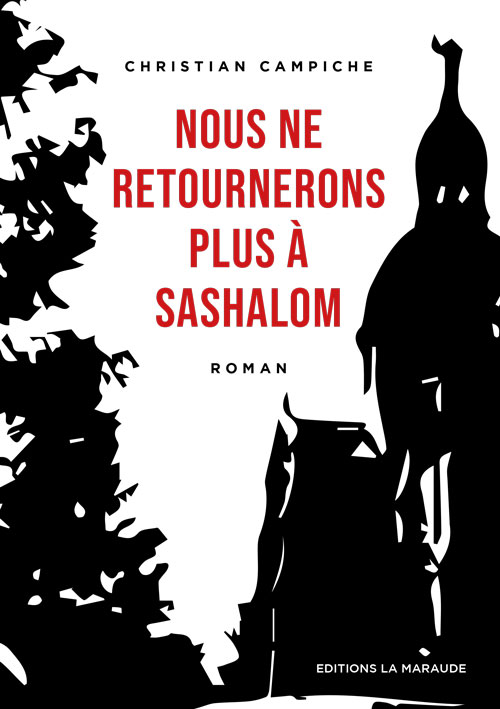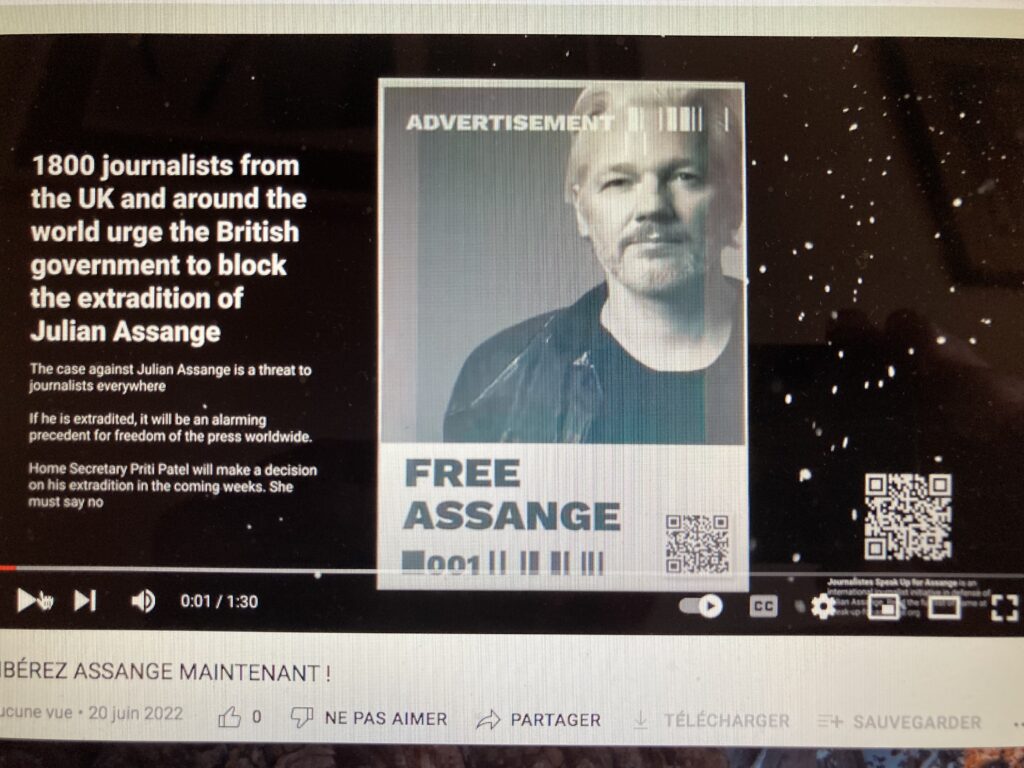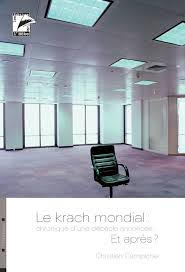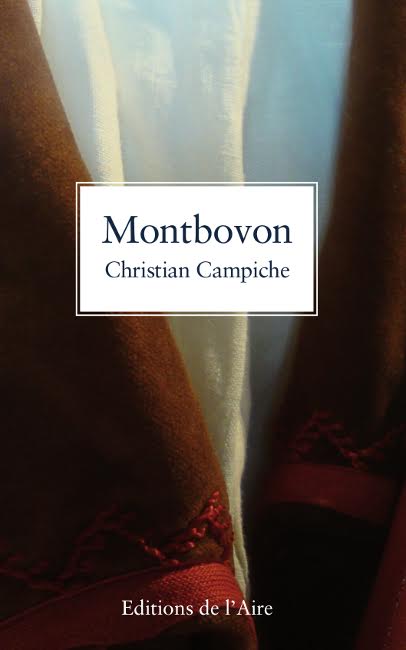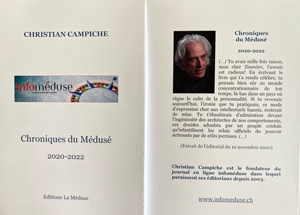En novembre 2013, le Jura et le Jura bernois sont invités à imaginer un avenir institutionnel commun en acceptant le principe de la création d’une constituante interjurassienne exploratoire. Ce n’est pas une répétition des plébiscites des années septante.
PAR JEAN-CLAUDE CREVOISIER
En 1994, les cantons de Berne et du Jura, sous le patronage de la Confédération, ont voulu sortir de la quasi-guerre des tranchées qui opposait stérilement et de façon véhémente, dans le Jura bernois, les autonomistes jurassiens et les partisans de Berne. C’est ainsi que, comme première étape, fut créée l’Assemblée interjurassienne (AIJ), réunissant paritairement des représentants du Jura et du Jura bernois. Cette assemblée reçut un double mandat, celui d’étudier les collaborations concrètes possibles entre les deux parties et celui de proposer une solution institutionnelle définitive à ce qu’il est convenu d’appeler la Question jurassienne.
Au cours de ses bientôt 20 ans d’existence, l’AIJ a identifié des convergences d’intérêt dans plusieurs domaines et a proposé les mesures à prendre pour répondre à ces besoins communs. Nous disons bien «proposé» car l’AIJ n’a pas été dotée d’un pouvoir de décision. Ses propositions, présentées sous la forme de résolutions, devaient obtenir l’accord des autorités des deux cantons concernés avant d’être éventuellement réalisées.
Quelques projets interjurassiens ont pu voir le jour. Le plus emblématique est peut-être la Fondation rurale interjurassienne (FRI), responsable de la formation et du perfectionnement des agriculteurs ainsi que de la promotion des produits du terroir jurassien. Emblématique parce, dans le Jura bernois, le projet a été porté par le monde agricole, milieu dont sont issus les plus farouches partisans du canton de Berne. L’intérêt bien compris des intéressés a ainsi fait passer au second plan le sentiment d’appartenance cantonale. Et c’est très bien ainsi.
D’autres projets se sont heurtés à des fins de non-recevoir. Les uns parce qu’ils ne s’inscrivaient pas dans la stratégie de l’un ou de l’autre des deux partenaires cantonaux. D’autres parce qu’ils touchaient aux prérogatives de certaines baronnies administratives (à Berne comme à Delémont), jalouses de leur micro-pouvoir. Mais le fait est que le travail de l’AIJ a permis de montrer d’une part que les habitants du Jura et du Jura bernois partageaient plusieurs intérêts concordants mais que d’autre part ils n’étaient pas du tout maîtres des suites données à leurs résolutions.
Aujourd’hui, une deuxième étape (après celle de la création de l’AIJ en 1994) est proposée aux citoyens des deux Jura. Ils ne doivent pas encore se prononcer sur leur appartenance cantonale, mais sur la création d’un lieu d’échange, une assemblée constituante, qui doit leur permettre d’imaginer et de finaliser, à titre exploratoire, un cadre institutionnel possiblement commun.
Ce cadre institutionnel, troisième étape, devra ensuite être soumis à un vote populaire dans chacun des deux territoires. Mais nous n’en sommes donc pas encore là, même si les arguments actuellement échangés par les parties en cause relèvent plutôt du “pour” ou du “contre” un grand canton du Jura.
S’agissant des partisans de Berne, on peut tout à fait comprendre leur intérêt à faire voter les citoyens du Jura bernois sur le fond, dès le vote du 24 novembre 2013. L’argumentaire des autonomistes sur le sujet est moins compréhensible. Sont-ils à ce point pressés d’en découdre qu’ils préfèrent brûler les étapes et ignorer la sagesse de la démarche proposée? Une démarche pédagogique, si l’on peut dire, comme l’a été celle de 1994 créant l’AIJ. Parce que si l’on votait prématurément sur le fond, notamment dans le Jura bernois, ce serait entre un projet très flou d’un nouveau Jura (dont peu de personnes voient à ce jour les contours) et un projet à peine moins flou, le statu quo très vaguement amélioré.
Rappelons qu’en démocratie, la majorité l’emporte dès qu’elle obtient la moitié plus un des suffrages. Or, les observateurs de la vie politique estiment que les citoyens du Jura bernois se partagent approximativement en trois camps: un tiers d’irréductibles partisans de Berne, un tiers d’autonomistes déterminés et un dernier tiers de citoyens non encore engagés qui attendent d’être convaincus par les arguments de l’un ou de l’autre camp. Ajoutons à cela, pour être complet, que la moitié du corps électoral actuel n’a pas vécu (dans sa chair pourrait-on dire) les affrontements et les turbulences des années septante.
C’est pourquoi il ne faut pas se tromper de cible. Il est illusoire d’espérer convaincre ceux qui ne jureront que par Berne, soit parce que d’origine bernoise, ils souhaitent rester citoyens bernois (ce qui est parfaitement légitime), soit parce qu’ils retirent de leur attachement au canton de Berne des avantages qu’ils ont peur de perdre (ce qui est compréhensible), soit encore parce que intimement conscients d’avoir préconisé un mauvais choix en 1974, ils craignent d’être confondus par une nouvelle et possible réalité jurassienne (ce qui est humain).
C’est donc l’électorat encore indécis, voire inquiet ou méfiant, qu’il convient de persuader de saisir la seconde chance offerte, sans risque immédiat, de dessiner l’avenir du pays.
Il faut donc écouter et accompagner notamment Patrick Gsteiger et Frédéric Charpié, deux responsables politiques du Jura bernois non séparatistes, qui se sont manifestés publiquement en posant correctement la question soumise aux citoyens jurassiens des deux bords en cette fin d’année 2013: «Doit-on ou non saisir la chance de négocier un cadre institutionnel pouvant éventuellement rassembler et faire cohabiter, à nouveau, les habitants des six districts jurassiens?». C’est bien sur cet enjeu, et lui seul, que le débat doit porter aujourd’hui.
Voter pour permettre l’élection d’une constituante interjurassienne, le 24 novembre prochain, ce n’est donc pas encore quitter le confort des deux «statu quo» bernois et jurassien.
Article paru dans “Courant d’Idées“