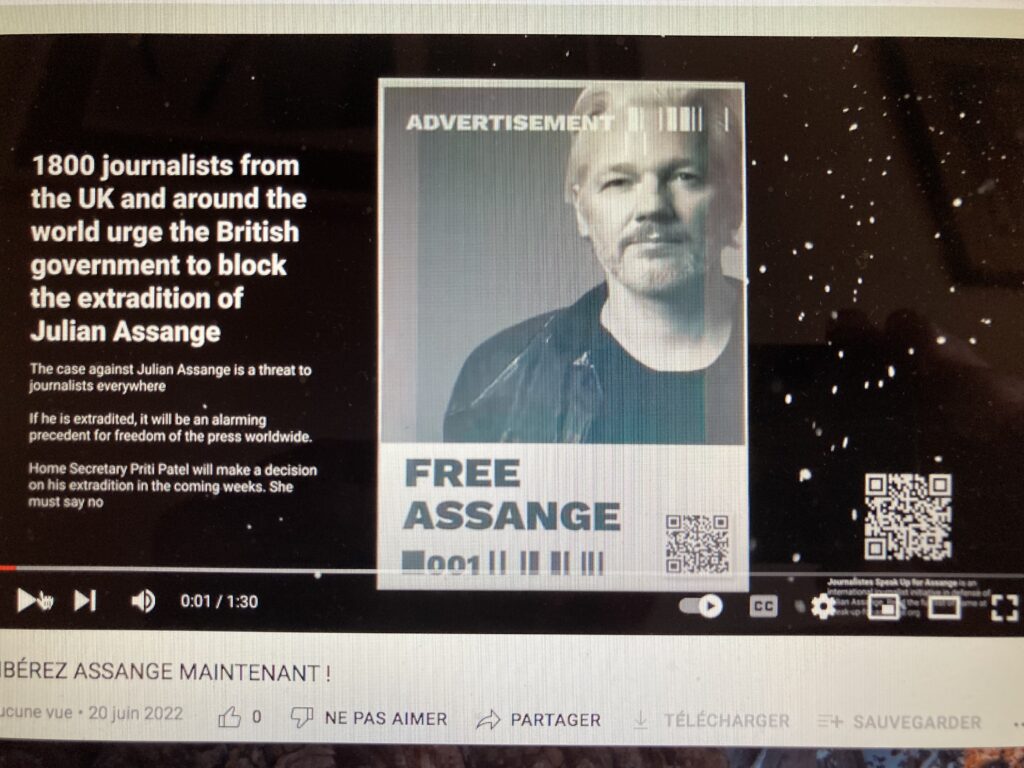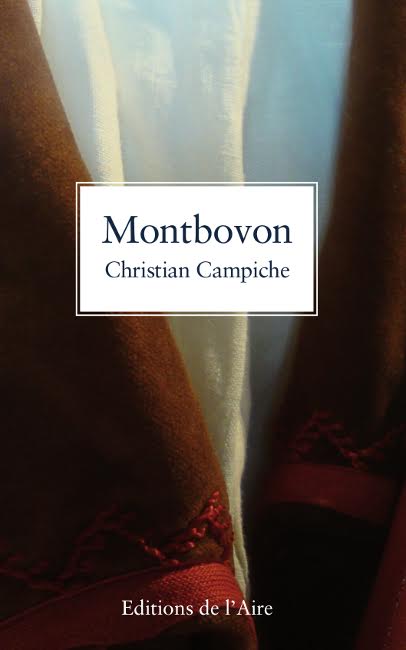Au cours des premiers mois de 2001, nombre d’observateurs se sont demandés comment George Bush parviendrait à sauver une économie exsangue, déjà usée par ses propres excès.
PAR CHRISTIAN CAMPICHE
Enron grillait les factures des consommateurs d’ampoules. Dans la rue, la contestation prenait de l’ampleur. Davos, l’OMC, la Banque mondiale étaient la cible des altermondialistes. Jamais autant d’ouvrages ne furent consacrés à la réflexion sur le pourquoi du comment d’un système générateur d’inégalités croissantes entre le Sud et le Nord.
Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, le libéralisme reprit du poil de la bête. Installé dans une dynamique de conquêtes, le Gouvernement américain ne se gêna pas d’instaurer un état d’exception. Pour protéger son industrie aéronautique et relancer Wall Street, Washington injecta des milliards. Le monde financier ébahi eut soudain la révélation d’un libéralisme à deux vitesses. L’ouverture des frontières, oui, mais seulement pour les gogos! En face, l’hyperpuissance disposait du privilège de verrouiller les marchés.
Avec la crise actuelle qui voit les fonds publics racheter allègrement des instituts financiers en détresse, la dichotomie devient carrément béante. La contradiction choque car l’argent du contribuable rend service à un système dévoyé par l’irresponsabilité de ses flambeurs.
Commentaire paru dans “La Liberté” du 1er octobre 2008