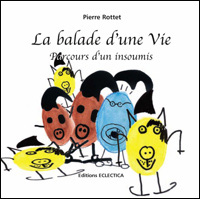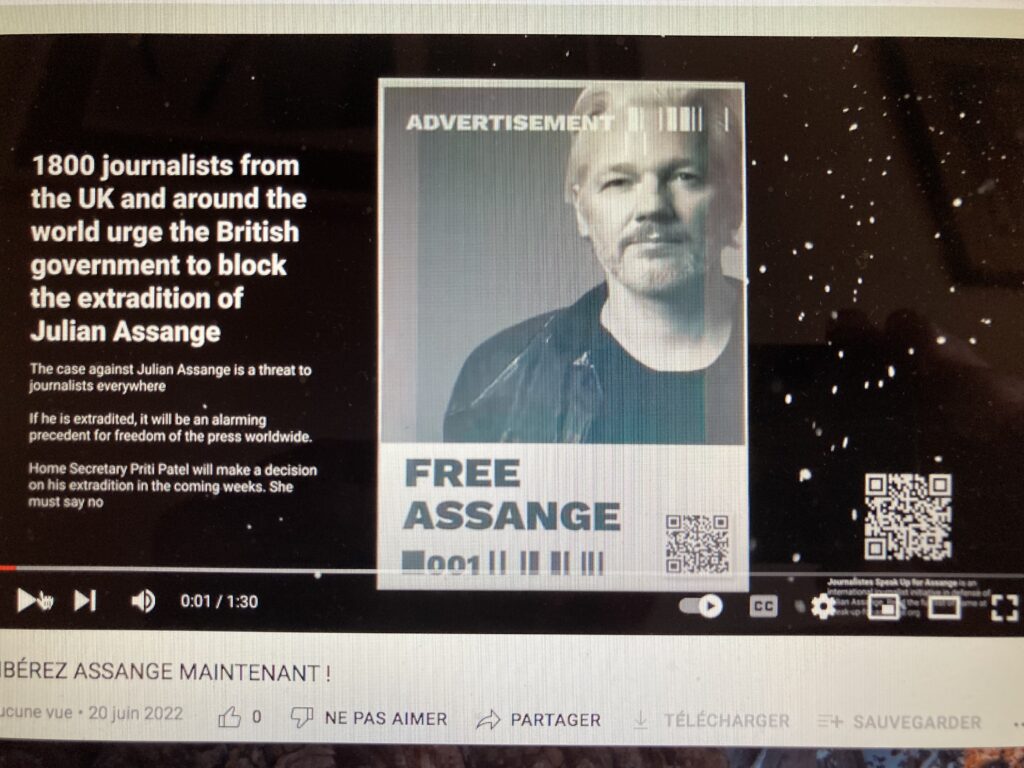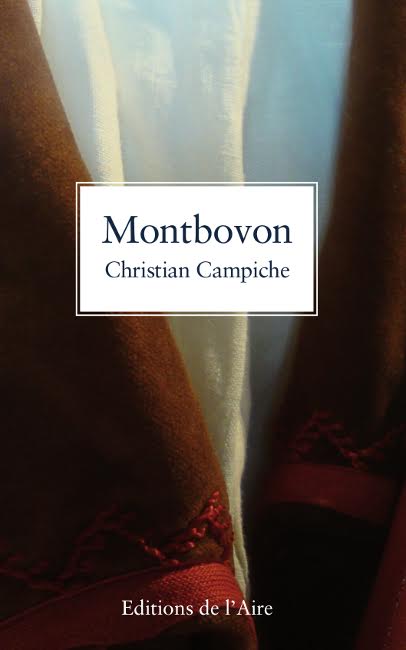PAR PIERRE ROTTET, LIMA
On m’avait prévenu, dit et répété: « Tu vas t’ennuyer loin de ton boulot, une fois ta retraite venue ». Tu parles! De toute ma vie, je n’ai jamais entendu semblable ineptie. Pareille idiotie. De toute ma vie, tu entends. Et Dieu sait combien je m’en suis farci, de telles affirmations. A dire vrai, je n’ai jamais été aussi occupé. Bon d’accord, je me suis toujours arrangé pour être le plus pénard possible au boulot. C’est bien simple, le jour où j’ai pris ma retraite, j’ai lancé à mes amis – à mes amis seulement, et non à mes collègues, tu saisis la nuance – j’ai lancé, donc, à qui m’écoutait, interloqué: « Je prends aujourd’hui ma retraite, pourtant, je n’ai pas le sentiment d’avoir travaillé dans ma vie ». Il est vrai qu’elle n’est pas banale, ma vie, comme en atteste ma « Balade de vie », décrite dans le contenu de mon dernier livre paru au printemps aux Editions Eclectica. Tu vois j’en profite pour faire de la pub pour mon « oeuvre ». Que je t’invite à acheter d’ailleurs.
D’accord, j’exagère à peine en affirmant être terriblement occupé. Car pour ce qui est de prendre mon temps, crois-mois, je le prends. Un peu comme s’il s’agissait d’une denrée porteuse d’une date limite. C’est dire si je savoure chaque moment, afin de ne rien laisser échapper de ce qui m’entoure. Mes yeux ne me le pardonneraient pas sinon, eux qui sont habitués à mon sens de l’observation que je crois affûté. Un peu comme si chaque moment vécu représentait un tableau plein de formes et de couleurs. Et avec cet été naissant en plus… Bon je ne te parlerai pas de ce soleil. Par solidarité avec toi, obligé de faire avec ce froid de canard. Non, j’ai autre chose à te narrer. Histoire que tu comprennes pourquoi j’aime ce pays, dans lequel tu vis des trucs que c’est pas à Fribourg que tu les vivrais. Ni à Berne, ni à Genève. Peut-être ailleurs. Mais pas en Suisse. Non, pas en Suisse.
Tiens, l’autre jour, je marchais, pas pressé, pour ne pas brusquer mon ventre qui faisait digestion. En plein travail, lui. Et sais-tu ce que j’ai vu. Attends, j’te raconte. C’est l’histoire d’un flic. Elle vaut bien ces quelques lignes. Surtout que ce que je vais te décrire, jamais encore j’avais eu la chance de le vivre. Et pourtant… Crois-moi, j’en ai observé, des flics sur cette terre. Des milliers. Il est vrai que rien ne ressemble plus à un flic qu’un autre. Hormis la couleur de l’uniforme, et du gars qui le porte. J’en ai connu, des policiers qui prennent leur pied en te collant une truffe. D’autres qui te foutent 100 balles avec un sourire plus large qu’un carnet de contre-danses. Ou qui te demandent de souffler dans le ballon, avec dans le regard cette envie féroce de répression. L’air de dire, vicieusement: « J’vais te coincer mon salaud ». Ou encore ceux, un peu à l’image des paillassons qui se font marcher dessus. Mais pas par n’importe qui. Et qui font semblant de ne rien voir. Sélectivement s’entend. Pour ne pas gêner un supérieur. Tu vois ce que je veux dire. Surtout que toute allusion avec ce qui s’est un jour passé à Fribourg avec un gros bonnet éméché – pour ne pas dire de mèche avec un subalterne – lors d’un accident de la circulation tôt le matin, ne pourrait être que coïncidence. Tu parles. Bref, tout cela pour te dire que j’en ai connu. Mais comme celui croisé l’autre jour à un important carrefour de Lima, jamais! Le soleil aidant, digestion oblige, il faisait la sieste, repus, ce sympathique flic rondouillard, au visage gracile, plus proche d’un papa Noël que d’un Rambo. Je l’ai regardé, droit dans ses paupières. Closes. Une bonne chose, me suis-je dit. Je n’allais pas m’en plaindre. Pour une fois que je rencontrais un flic qui fermait les yeux.
A propos de flic. Où de ce qui est sensé être son contraire à savoir les malfrats, j’ai une autre histoire à te raconter. Tu vois, il s’en passe des choses ici à Lima. T’as beau mettre une sourdine à tes activités. De journaliste qui plus est. Tu n’en demeures pas moins toujours le témoin d’un monde en mouvement. Tiens, l’autre jour, je me suis retrouvé dans le quartier de la Victoria, à Lima, où le touriste ne se rend pas. Parce qu’il vaut mieux l’éviter. D’abord parce qu’il n’est pas beau. Et que même par temps de soleil, la lumière de l’astre ne parvient pas à lui donner de la couleur. De l’éclat. Dans cet endroit, crois-moi, tu peux tout trouver. Y compris la voiture qu’on vient de te piquer. En pièces détachées, certes, mais pour un prix dérisoire. Ensuite, parce que les voleurs à la tire de la capitale péruvienne semblent s’être donnés rendez-vous dans ce périmètre pour t’alléger du superflu: de ton porte-monnaie. Dans le meilleur des cas.
Je cause, j’écris plutôt. Pour allonger davantage encore cette lettre. Et je m’en veux. Vu que tu as moins le temps que moi. Or donc, disais-je, je me trouvais l’autre jour à la Victoria, dans un endroit nommé Gamarra. Une zone grande presque comme la moité de Fribourg, où plus de 20’000 entreprises ont pignon sur rue, afin d”y vendre des habits. Du bébé à l’ancien. Tout ce que le textile peut t’apporter sous forme de produit fini. Et pas uniquement. Des souliers de foot magiques, qui te font marquer des buts sans même que tu le veuilles. Tu vois ce que je veux dire. Enfin. Pour faire simple, il s’agit du plus grand marché industriel de vêtements d’Amérique du sud, protégé par des flics. Et même par les commerçants du coin. Faut dire que chaque jour, des millions de dollars transitent d’une poche à un guichet de banque. L’endroit est sûr. En théorie du moins. Mais en théorie seulement. En ce début de vendredi après-midi, j’étais en quête de bonnes affaires, histoire de garnir ma garde-robe. Et de trouver des équipements de foot pour mon équipe de Matran qui, comme tu le sais, viendra en avril pour se couvrir de gloire au Pérou.
En ce début d’après-midi, donc, un immense vacarme s’est soudain ajouté à l’inhabituel brouhaha, avec cela qu’il était plus confus, plus exubérant qu’à l’accoutumée, fait des cris d’une foule en transe d’achats en cette période de Noël. Subitement pressés, les gens s’enfuyaient, s’empressant de quitter les lieux, en courant tous azimuts pour échapper des alentours d’une banque. Qui venait d’être attaquée. A coups de revolvers. Assourdissantes détonations. J’étais à 20 mètres de la banque. Les flics ont cerné l’endroit. Mais pas le bistrot situé dans une rue avoisinante d’où, du deuxième étage vitré, j’ai pu suivre en spectateur avisé l’évolution des événements. Devant un quart de poulet à la braise, des frites et une salade. La main sur la fourchette. L’oeil rivé à la rue. L’attaque, avec prise d’otages des clients et du personnel, s’est terminée 7 heures plus tard. Avec en sus la mort du malfrat, abattu d’une balle dans le crâne. Le mec, vois-tu, il a quitté ce monde avec quelque chose dans la tête, du plomb, un projectile de flic, tu m’diras, lui qui devait l’avoir bien vide, cette tête. Fallait-il qu’il soit sacrément idiot et sans cervelle, le gus, ou bien vachement désespéré pour tenter l’impossible, afin de garnir sa tirelire à l’approche des fêtes de fin d’année. Et faire comme tout le monde, dépenser. Enfin, quand je dis tout le monde…
Le plus drôle, dans cette histoire, enfin le plus drôle, si tu me passes l’expression, est que dans le bus, qui me ramenait vers plus de soleil, deux femmes, témoins elles aussi de l’attaque, commentaient l’action, encore sous le coup de l’émotion, de la peur qui se lisait dans leurs yeux. « Vous avez eu la trouille de votre vie », glissais-je à l’une d’elle, la plus jolie sans doute. J’n’ai jamais pu m’empêcher de « coqueter » devant une belle femme. Pour la traduction, tu repasseras. Y’a pas l’équivalent. La trouille de sa vie? Tu parles! La routine, pour elle, qui s’était vue un jour agresser dans un taxi par un quidam, révolver à la main. Pour la voler. Comme elle s’était fait voler dans son propre appartement quelques mois auparavant, par trois types armés. Qui s’étaient envolés avec tout ce que la maison contenait de valeur.
Le courant de la vie quotidienne, tu m’diras. Avec raison. Qui fait partie des faits divers, dont se repaissent les journaux. Ici aussi, la violence, on la condamne, on ne l’aime pas. Mais bon Dieu, elle fait vendre les feuilles à 4 sous. Et des images à la TV, pour le bon peuple. Faudrait pas te méprendre. En réalité, je ne pense pas qu’il y ait plus de voleurs ici. Un peu plus de violence, d’accord, mais plus de voleurs que chez nous: non, à dire vrai. La différence, vois-tu, est qu’ici, qu’ils soient Péruviens, Colombiens, Brésiliens où que sais-je, si les flics les attrapent, ils les foutent en taule. Mais pas question de renvoyer les étranger chez eux. Tu vois ce que je veux dire. Les voleurs sévissent, les gangsters aussi. Mais pas l’UDC. Pas encore présente ici. Dieu Merci!
Tu sais, cette histoire d’attaque me fait penser à quelque chose que j’ai vécue à Lima. Il y a bien longtemps. Enfin, un bout de temps. En 1988, je crois, à l’époque où j’étais correspondant dans cette capitale pour des médias suisses. Moi aussi j’ai un jour été pris en otage. Un épisode que je commente d’ailleurs dans ma «Balade d’une vie – Parcours d’un insoumis», encore un coup de pub, pour ceux qui ne l’auraient pas lue. Que j’te résume ici, au cas où… Des membres du MRTA, le Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru avaient investi les locaux de l’Agence France presse, où je bossais pour mes journaux. Parmi les 5 ou 6 membres du commandos figurait une jeune fille, masquée de noir. Sous la menace de son revolver, tellement plus grand que ses petites mains, elle m’avait obligé à rédiger un texte. Un communiqué. Que j’aurais eu mauvaise grâce à refuser. On ne saurait le faire, avec un pistolet pointé sur sa tête. Tu vois, il faut savoir éviter les coups. De feu de préférence.
J’ai souvent pensé à ce moment-là. A ce regard de gamine aux yeux noirs, le cheveu abondant, plus anthracite que le charbon avant de brûler. Elle pointait son instrument mortel sur moi. Son outil de guérillera en couette, si j’ose dire. J’ai en mémoire ses yeux sans angoisse, sans colère, déterminés. Elle ne devait guère avoir plus de 16 ans, la rebelle. Elle se battait pour une cause qu’elle pensait juste, pour que dehors, des enfants n’aient plus à mendier, à piquer dans le sac à main de petites vieilles plus pauvres que leurs agresseurs. Son chemin passait par la violence. Elle n’était pas pire que d’autres. Tu vois ce que je veux dire. J’aurai du reste l’occasion de revenir sur cet aspect. Lorsque viendra le moment de parler de politique. J’aime bien, à l’occasion, aborder ce sujet.
A propos de politique, et ce sera ma conclusion pour aujourd’hui, j’ai aimé cet hommage rendu à l’ex-président brésilien Lula, qui résume à lui seul ce qu’un jour, peut-être, je te ferai partager à propos de l’Amérique latine… histoire de la comprendre. Où du moins de t’arracher à ce préjugé qui te colle à la peau, à cause d’une info tronquée très souvent. Et pas seulement par des médias conservateurs. Non, aussi – et là c’est moins pardonnable – par des journaux dits de gauche, comme « El Pais » édité à Madrid, ou « Libération », à Paris, qui y vont de leurs certitudes… caviardées. Devant un parterre de chefs d’Etat latinos, Lula a ainsi résumé ses acquis: “on ne nous traite plus comme avant. Nous ne verrons plus quelqu’un plaisanter parce qu’un travailleur a obtenu son diplôme ou parce qu’un Indien a été élu président en Bolivie. Nous avons construit quelque chose de neuf, qui ressemble à la dignité, en Amérique latine”. C’est tellement vrai.