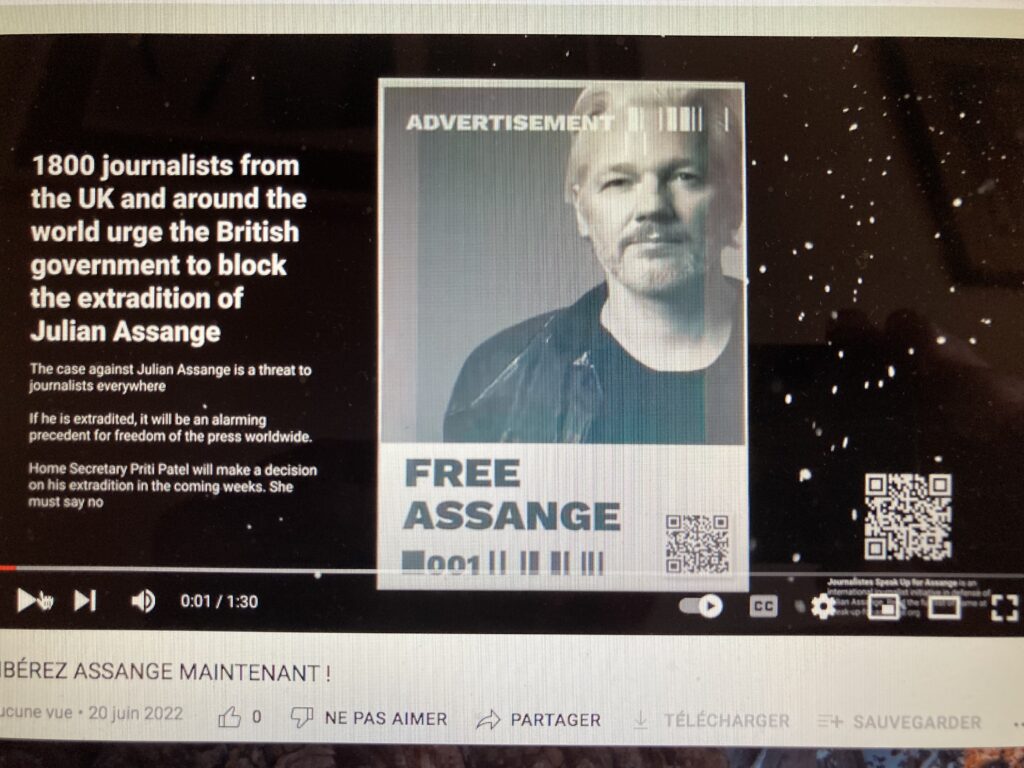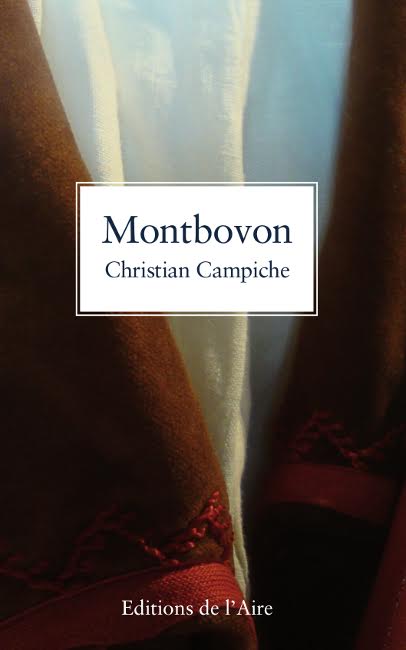«Sauvages», «d’élevage» ou «domestiques»: les catégories que nous appliquons aux animaux sans même y penser ont été façonnées par l’histoire du rapport des hommes à la nature, à la nourriture, à la transcendance et sans doute aussi des hommes entre eux.
PAR MICHAEL RODRIGUEZ
Les animaux qui vivent aujourd’hui dans nos maisons ou nos champs dérivent d’espèces sauvages. Parmi les bêtes familières de la civilisation européenne, le chien serait le plus ancien. Le loup, son «ancêtre», aurait été domestiqué pour la première fois autour de 12’000 avant J-C en Sibérie*. L’égagre, le mouflon, le sanglier et l’aurochs ont donné la chèvre, le mouton, le cochon et la vache, probablement entre – 8500 et – 7500 au Proche-Orient, principal berceau de l’élevage. Le chat aurait été apprivoisé autour de – 2000 en Egypte. Le coq et le paons étaient déjà domestiqués au néolithique en Inde, et n’ont été introduits en Europe qu’entre le VIIe et le VIe siècle avant J-C.
La domestication a été un phénomène progressif. Les hommes auraient commencé à capturer et à domestiquer des égagres et des mouflons dans une optique de régulation du gibier, afin d’éviter son extinction. Le véritable essor de l’élevage est cependant lié à la sédentarisation, qui facilitait la gestion des troupeaux, et à la naissance de l’agriculture. Certaines espèces, comme le sanglier et l’aurochs, auraient été attirées dans le voisinage des hommes par les champs cultivés.
La quête de viande est une des motivations de l’élevage, mais probablement pas la seule. Le désir d’exercer un contrôle sur la nature, voire de la dominer, ainsi que le besoin de compagnie ont également joué un rôle. En revanche, l’utilisation du lait, de laine et de la traction animale semblent avoir été des conséquences plutôt que des causes du phénomène.
Agriculture et élevage ont d’emblée entretenu des rapports étroits – et parfois conflictuels, en raison des dégâts occasionnés aux champs par les animaux. Dès le Moyen-Âge au moins, mais probablement dès l’Antiquité, le bétail était mis en pâture sur les terres laissées en friche, afin qu’ils les fertilisent tout en se nourrissant des restes de cultures.
Les catégories dans lesquelles nous rangeons les animaux font parfois oublier que les séparations entre elles ne sont pas toujours si nettes, ou ne l’ont pas toujours été. Avant le XIXe siècle et la naissance de l’agriculture intensive, les troupeaux vivaient souvent en semi-liberté, en particulier dans les forêts. De l’animal sauvage à l’animal d’élevage, il y avait donc une assez grande perméabilité.
L’actuel mouflon corse, par exemple, est issu de moutons domestiques qui se sont à nouveau «ensauvagés».
L’homme a-t-il le droit de tuer pour les manger les animaux qu’il a domestiqués? Si oui, lesquels et à quelles conditions ? Cette question s’est souvent posée au cours de l’histoire. Chaque culture a d’ailleurs ses interdits, ses tabous, qui découlent de liens particuliers tissés entre les hommes et certains animaux, ou du caractère sacré (ou au contraire impur) de certaines bêtes. L’affaire des «lasagnes au cheval» a d’abord choqué au Royaume-Uni, où cet animal est vénéré. De même, le fait de manger du chien ou du chat est considéré chez nous comme choquant, alors que cette pratique est courante dans certains pays d’Asie, où l’on n’imaginerait en revanche pas se nourrir de grenouilles.
Hormis ces quelques restrictions, la chair animale occupe, dans la société occidentale moderne, la place d’un aliment (presque) comme les autres. Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Dans la Grèce antique aussi bien que dans la tradition judaïque, le fait de manger de la viande était indissociable de l’idée de sacrifice. Autour de cet acte rituel se jouait une relation triangulaire entre les dieux, les animaux et les hommes. Cette place dévolue à l’animal ne lui épargnait évidemment pas la souffrance, mais elle lui donnait un statut autre que celui d’une chose.
Dans la Grèce antique, plusieurs courants végétariens existaient. Les adeptes de Pythagore ne mangeaient pas d’animaux car ils croyaient qu’une même âme peut animer successivement plusieurs êtres vivants. Un animal pouvait donc renfermer l’âme d’un ancêtre. Pour d’autres, la consommation de viande – surtout de viande rouge – excitait les basses pulsions de l’homme et l’éloignait des dieux. Le penseur et historien Plutarque jugeait problématique de manger des animaux terrestres, car ils partagent avec les hommes le même monde. Le plus choquant étant, selon lui, de se repaître d’animaux domestiques qui partagent notre quotidien, comme la brebis, le coq annonciateur du matin et le boeuf de labour.
Durant l’Antiquité et jusqu’au Moyen-Âge, il était admis que les animaux avaient une âme, au sens de «principe de vie», de «souffle». Mais, selon Aristote, ils n’avaient qu’une «âme sensitive», alors que les hommes avaient en sus une «âme rationnelle». En tant qu’êtres supérieurs, ces derniers avaient donc le droit d’utiliser les animaux pour leurs besoins.
L’époque des Lumières a marqué un tournant dans la compréhension du monde animal. Au XVIIe siècle, le philosophe et naturaliste René Descartes a soutenu l’idée que la vie des animaux ne s’expliquait pas par l’existence d’une âme, mais par une sorte d’automatisme perfectionné. L’âme étant par essence immortelle, seuls les hommes pouvaient en être pourvus.
Disciple de Descartes, le philosophe Nicolas Malebranche a poussé plus loin cette idée, en affirmant que les animaux ne souffraient pas. Leurs réactions pouvaient avoir l’apparence de la douleur mais n’étaient que des mouvements mécaniques.
Cette conception a fortement imprégné les expérimentations menées à des fins scientifiques sur les animaux. Elle a probablement préparé le terrain à l’élevage intensif, qui s’est développé dès le XIX e siècle à la faveur de l’industrialisation et de l’économie capitaliste.
Certains animaux ont été perçus uniquement comme des «machines» à transformer de la biomasse en protéines, et intégrés à un processus de production dont ils sont des pièces parmi d’autres.
Le rapport aux animaux n’a cependant pas cessé de susciter des controverses. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau a soutenu que les hommes ont des devoirs à leur égard car eux aussi sont doués de sensibilité. Le philosophe britannique Jeremy Bentham a fait valoir que cette capacité de souffrir (et, à l’inverse, de ressentir du plaisir) est le seul véritable critère qui détermine le statut moral des bêtes. Il a inspiré tout un courant de pensée encore vivace, selon lequel les animaux ont des intérêts propres et ne doivent pas souffrir inutilement.
Cette idée se retrouve, sous une forme diluée, dans la législation suisse. La constitution énonce en effet le principe de «dignité de la créature». Ce terme de «créature» réintroduit d’ailleurs curieusement l’idée d’une transcendance, comme s’il fallait l’intervention d’un créateur ou d’une cause première pour arracher l’animal à une pure condition d’objet.
La portée de cette disposition reste en outre difficile à saisir. Qu’est-ce que la dignité d’une vache ou d’une poule? Implique-t-elle de leur laisser la possibilité de jouir de leurs capacités naturelles? Mais alors, est-il conforme à leur «dignité» de séparer la vache du veau pour la production de lait? Et à celle des poules de les empêcher de se reproduire? Les contradictions entre le bien-être animal, que l’industrie tente de se réapproprier pour redorer son image, et la logique de production de masse, sont loin d’être résolues.
*Eric Baratay, Et l’homme créa l’animal. Odile Jacob, 2003
Article paru dans «Courant d’Idées». Ainsi se conclut la série de Michaël Rodriguez “La poule industrielle a tout envahi”. Les textes sont groupés dans une brochure “Faut-il abandonner la poule à l’industrie?“, 47 pp, 9 francs. Elle peut être commandée auprès de M. Reto Cadotsch, 9 quai Capo d’Istria, 1205 Genève, raeto.cadotsch@wanadoo.fr