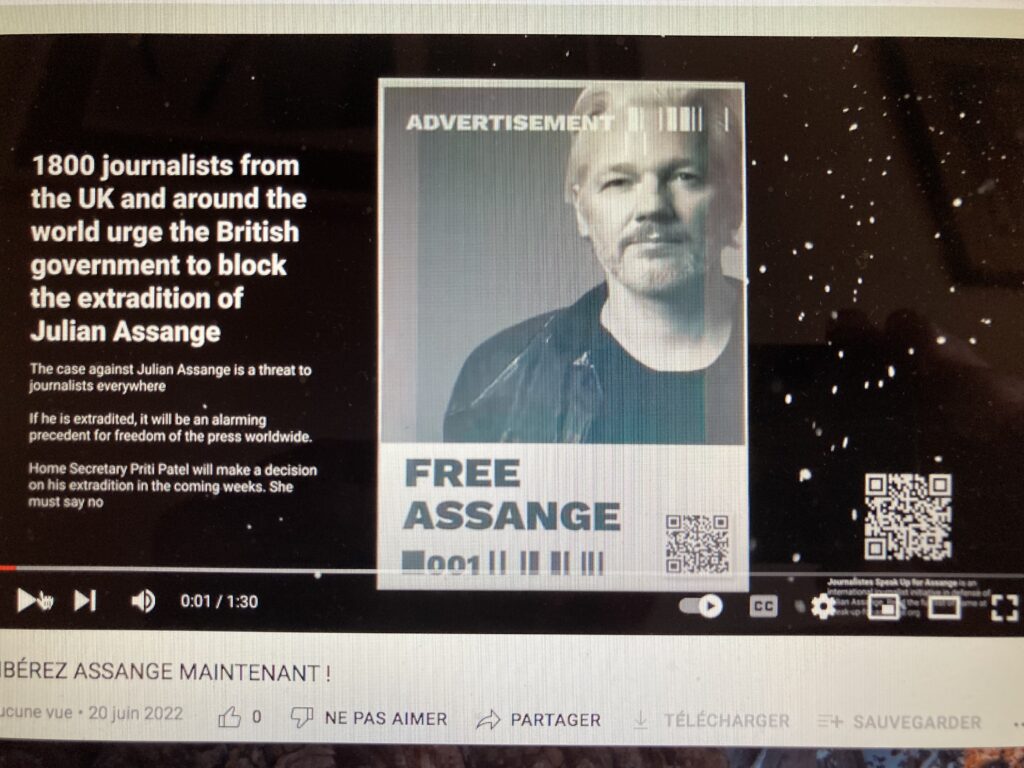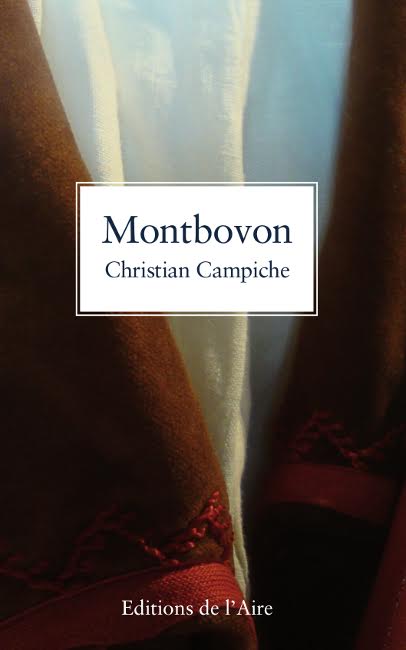Que faire face à l’offensive en Suisse alémanique contre l’apprentissage du français à l’école comme première langue étrangère? Le cliché de la bonne entente confédérale montre ici ses limites.
Par Jean-Claude Crevoisier
Il est bon de s’interroger sur les raisons du désamour croissant outre Sarine pour la langue française. Le repli généralisé sur les patois régionaux, au détriment du Hochdeutsch, livre une première clé de lecture du phénomène. Les jeunes enfants baignent exclusivement dans ces idiomes, dès leur naissance, dans la famille d’abord puis «dans la rue» et parfois jusqu’au jardin d’enfants. Et les radios, tant locales que nationales, prolongent encore cette immersion tout au long de la vie. Au point que nombre de nos concitoyens alémaniques affirment que l’allemand est pour eux la première langue étrangère qu’on les oblige très jeunes à maîtriser. La scolarité primaire les rendrait de ce fait déjà bilingues!
Ajoutons qu’ils n’ont pas, avec le «bon allemand», le même rapport affectif que les Romands avec le français. On a évoqué plusieurs raisons à cela. Citons le refus d’endosser une parenté avec les Allemands, premiers responsables des horreurs de la dernière guerre mondiale et un complexe compréhensible face à l’agilité verbale de leurs voisins du Nord.
La mondialisation des relations surtout économiques a là-dessus imposé chez nous les modèles anglo-saxons de développement et a par conséquent induit une prétendue supériorité de l’anglais comme langue de communication (en attendant l’arrivée déjà programmée du chinois notamment comme nouvelle référence mondiale).
La préférence de l’anglais chez les alémaniques s’explique d’ailleurs aisément. Sa syntaxe est significativement moins complexe que celle du français et même celle du «bon allemand».
Ne négligeons pas non plus l’extension d’une incompréhension de moins en moins refrénée voire d’une allergie latente des alémaniques pour leurs concitoyens latins. Une attitude qui à elle seule expliquerait aussi l’absence d’envie de privilégier l’apprentissage du français.
Acceptons dès lors les conséquences de cette réalité. Sans nous tromper beaucoup, nous pouvons penser que le «Hochdeutsch» n’est la langue vraiment maternelle d’aucun Suisse (mis à part bien sûr dans les familles allemandes naturalisées). Nous pourrions donc abandonner l’allemand comme langue nationale et lui substituer l’anglais. Chaque communauté linguistique serait alors invitée à maîtriser parfaitement sa langue maternelle, l’italien au Tessin et dans le sud des Grisons, le français en Suisse romande et les différentes formes de patois alémaniques dans les cantons d’Outre-Sarine. L’anglais, première langue étrangère (après la langue maternelle) devenu obligatoire partout comme langue nationale, serait choisi et imposé comme langue de communication entre les différentes parties de la Suisse. La plupart des hautes écoles suisses montrent déjà ce chemin. Et tous peuvent imaginer le rééquilibrage intercommunautaire que cela pourrait induire aux Chambres fédérales.
D’aucuns pourraient me reprocher de faire ainsi acte d’allégeance à une langue impérialiste (décadente de surcroît diront certains). Je pense en revanche qu’il vaut mieux vouloir, en pleine connaissance de cause, ce qu’on ne pourra de toute façon pas empêcher à terme.
Le cas échéant, comme le plurilinguisme est source avérée d’enrichissement culturel personnel, chacun pourrait ensuite opter, comme deuxième langue étrangère, qui pour l’espagnol, qui pour le russe, qui pour le chinois ou l’arabe (pour ne citer que les langues d’ores et déjà promises à de brillants avenirs), et qui pourquoi pas même pour l’allemand.
N’est-ce pas là «l’œuf de Collomb» pour garantir la paix des langues dans un pays qui serait ainsi exclusivement formé de minorités linguistiques?
Article paru dans “Courant d’Idées“.