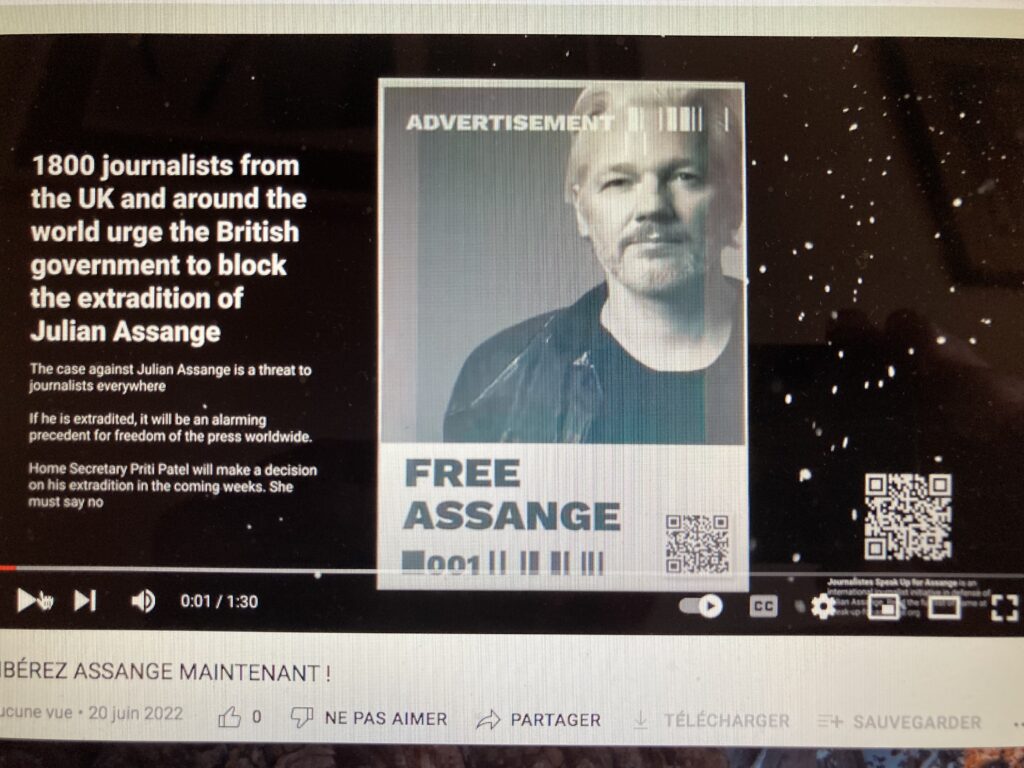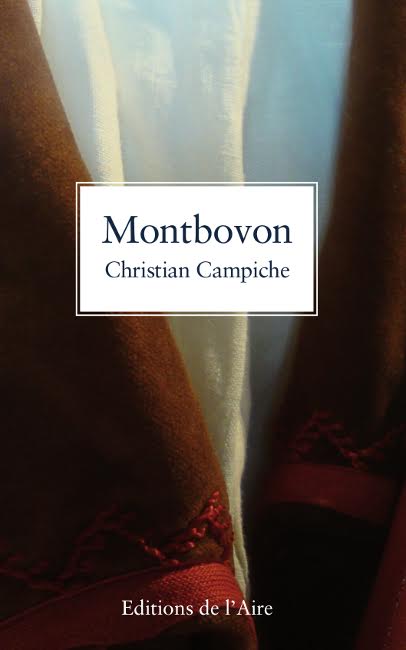PAR JEAN-PHILIPPE CHENAUX
Homme de traditions et de convictions fortes, explorateur plein d’empathie pour les peuples oubliés ou en voie de disparition, Consul général d’une monarchie aussi authentique qu’éphémère, l’écrivain Jean Raspail nous a quittés peu avant son 95e anniversaire, le jour même – simple coïncidence, bien sûr – où l’on commençait un peu partout à déboulonner les statues.
Il y avait une foule immense, le 17 juin à Paris, en l’église Saint-Roch, pour accompagner le capitaine de frégate dans son dernier voyage, celui qui l’a conduit du Royaume patagon de l’utopie à notre « au-delà des mers », l’autre Royaume. A un journaliste qui lui demandait quelles étaient les principales qualités du défunt, l’amiral Edouard Guillaud, ancien chef d’Etat-major des armées, a mentionné « une énergie inépuisable, un humour que l’on qualifierait volontiers de britannique et une capacité d’autodérision très rassurante ». Pour le romancier et grand voyageur Sylvain Tesson, « Raspail, c’est la consolation du déclin historique par l’immensité de la géographie ; l’espace vide était pour lui le conservatoire des temps désagrégés et des vertus oubliées ». Il était fasciné par les frontières et surtout par ce qui se cache derrière. En guise d’épitaphe, Sylvain Tesson propose : « Allez voir là-bas si le rêve y était ».
L’épopée raspailienne commence en 1949 avec la descente en canoë de Québec à La Nouvelle-Orléans, sur les traces des découvreurs du Mississipi ; elle se poursuit avec l’expédition automobile Terre de Feu – Alaska, puis avec la mission française d’études historiques et ethnographiques aux anciens pays incas et celle chez les Aïnous du Hokkaïdo. Des reportages réalisés caméra au poing dans les « Terres saintes et profanes » du Proche-Orient, à Hong-Kong, à Haïti, aux Antilles, chez les Peaux-Rouges, et même à Venise, captivent un nombreux public francophone.
Lors de son premier voyage en Terre de Feu, Jean Raspail croise dans le détroit de Magellan l’un des derniers canots des Alakalufs, ce peuple en voie d’extinction qui succombe au progrès et à l’arrivée de l’homme blanc après avoir résisté pendant des siècles aux furies océanes et à un climat d’une extrême rigueur. Quelques braises au centre de l’embarcation pour faire renaître le feu et ne pas perdre la flamme au milieu de la glace. Deux femmes en haillons, un enfant triste, trois rameurs à moitié nus et aux yeux d’outre-monde. Cette scène a hanté son roman Le Jeu du roi et il va l’exorciser dans Qui se souvient des Hommes…
Le Camp des Saints, écrit en 1972 sur le mode apocalyptique, remporte un énorme succès, mais lui vaut des avanies. Il décrit l’afflux d’un million d’immigrants affamés sur la Côte d’Azur et les réactions que suscite l’irruption de cette armada dans une France rongée de remords. Jean Cau voit d’emblée en Jean Raspail un « implacable historien de notre futur ». Hervé Bazin, jury Goncourt, salue « un livre percutant et courageux ». Bernard Clavel évoque « un livre redoutable, à la fois bouleversant et révoltant dont nous pouvons craindre qu’il soit prophétique ». Pour Slobodan Despot, c’est bien le roman en langue française « le plus politiquement incorrect de ce dernier demi-siècle » ; en comparaison, « Soumission de Houellebecq a le souffle d’un acte notarié ». A gauche, on y relève des traits xénophobes, ce qui vaut à son auteur d’être exclu de la république des lettres. Quel cadeau pour celui qui a chanté toute sa vie les peuples amérindiens : « Un écrivain a le droit d’être multiple, complexe, nuancé, chatoyant », plaide Sylvain Tesson. Et aujourd’hui, la prophétie du Camp des Saints se déploie à ciel ouvert dans les rues d’Occident : « Ceux qui la niaient le plus farouchement sont passés du déni à l’accommodement. Des foules euphoriques dansent sur le cadavre de la civilisation de l’homme blanc » (Slobodan Despot).
De toute façon, il serait bien réducteur de présenter Jean Raspail comme « l’auteur du Camp des Saints ». Il laisse une œuvre foisonnante avec des romans aussi fascinants que Septentrion, Sire, un livre qui inaugure « la mystique-fiction » (Renaud Matignon), Les Sept Cavaliers, L’Anneau du Pêcheur, Les Royaumes de Borée, Les Pikkendorff, formidable saga d’une famille européenne mythique qui exprime la vision raspailienne de la « vraie Europe », et Miséricorde, un roman mystique et intime.
Sans oublier, bien sûr, Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie (1981), Grand Prix du roman de l’Académie française. Ayant assumé depuis 1983 la fonction toute honorifique de vice-consul de Patagonie à Lausanne, alors que mon confrère Raoul Riesen, « Le Renquilleur » et « Le Furet » de la presse genevoise, acceptait la même charge outre-Versoix, je n’aurais garde de le faire.
En octobre 1978, Jean Raspail se proclame Consul général du Royaume de Patagonie à Paris. Il y représente le gouvernement de Sa Majesté Orélie-Antoine Ier. Né de Tounens, ce modeste avoué périgourdin proclamé roi par des tribus amérindiennes régna pendant six semaines, en 1860, sur cette contrée lointaine de l’Amérique australe avant d’être livré à l’armée chilienne, puis rapatrié en France. Hanté par son rêve, le monarque revint quelques années plus tard, pour être à nouveau expulsé. Prenant le relais du symbole, le Consul général se dote d’une Chancellerie, animée par François Tulli, d’un drapeau, d’un hymne national. Des dizaines de consulats et d’associations de droit patagon, dont un Cercle de l’Inutile, éclosent aux quatre coins du monde. Aujourd’hui, ce véritable « isolat », au sens ethnographique du terme, compte plus de cinq mille sujets patagons. Pour Jean Raspail, c’est un jeu. Le « jeu du roi ». Un jeu de l’esprit, une sorte de roman continu de la patrie imaginaire : « La Patagonie peut devenir défi, simulacre de conquête, provocation, pied de nez, refus, refuge, rêverie, regret, canular, voire dérision ou dégoût, ou plus simplement une façon de s’amuser peu communément, mais elle doit rester un jeu ».
« Je suis d’abord mes propres pas »
La Patagonie a mené quelques actions diplomatiques retentissantes. Au début de la guerre des Malouines, la presse a largement diffusé un ultimatum patagon enjoignant aux deux belligérants d’évacuer les eaux territoriales patagones. En guise de protestation, une division navale légère de la Flotte patagone a envahi l’archipel des Minquiers, dans la Manche, et y a fixé sa capitale, Port-Tounens ; elle y a hissé le pavillon royal bleu blanc vert après avoir amené l’Union Jack, et y a scellé une petite plaque pour marquer son passage ; ce n’est qu’après quatre jours qu’un bateau de guerre britannique est parvenu à réoccuper l’archipel. Soigneusement plié, le drapeau britannique a été remis solennellement à un secrétaire de l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris et la presse d’outre-Manche, stupéfaite, a consacré plusieurs articles de « une » à cette équipée. Plus récemment, et avant même que les Etats-Unis n’y installent le leur, la Patagonie a ouvert un consulat à Jérusalem ; notre compatriote Daniel Laufer, qui a suivi des cours d’hébreu biblique, en est le vice-consul honoraire, avec résidence à Pully.
Dans Le roi au-delà de la mer, on lit cette phrase qui caractérise si bien Jean Raspail : « Quand on représente une cause (presque) perdue, il faut sonner de la trompette, sauter sur son cheval et tenter la dernière chance, faute de quoi l’on meurt de vieillesse triste au fond de la forteresse oubliée que personne n’assiège plus parce que la vie s’en est allée ailleurs. »
Au-delà des causes que l’on défend, il y a la manière de le faire. Jean Raspail était de la race de ces écrivains pour lesquels l’attitude prime : « l’attitude, c’est souvent la colonne vertébrale de l’âme » (Les Sept Cavaliers). « Il ne s’agit pas d’avoir encore des illusions, mais de se tenir, droit et fier, comme si l’on en avait encore, pour manifester respect et attachement à ce qui n’est plus ». Il accordait aussi beaucoup d’importance à la fidélité.Fidélité à l’égard de ses rêves d’enfant et de ses propres convictions. Il s’en explique dans L’Anneau du pêcheur : « On ne renonce pas à la fidélité. La fidélité n’est peut-être pas une fin en soi et on perd beaucoup de monde en chemin par refus de transiger, mais pourquoi transigerait-on quand on tient la vérité ? » Il attribue aux Pikkendorff cette devise, qu’il a bien sûr fait sienne : « Je suis d’abord mes propres pas ». C’est en « suivant ses propres pas » que, par fidélité à ses convictions monarchistes, il a organisé presque seul la célébration, le 21 janvier 1993, place de la Concorde, du 200e anniversaire de l’exécution de Louis XVI. L’ambassadeur des Etats-Unis s’était joint à la foule et avait déposé une gerbe.
Merci, Monsieur le Consul général, de nous avoir fait partager votre rêve. Le Jeu du roi continue.
La Nation, No 2152