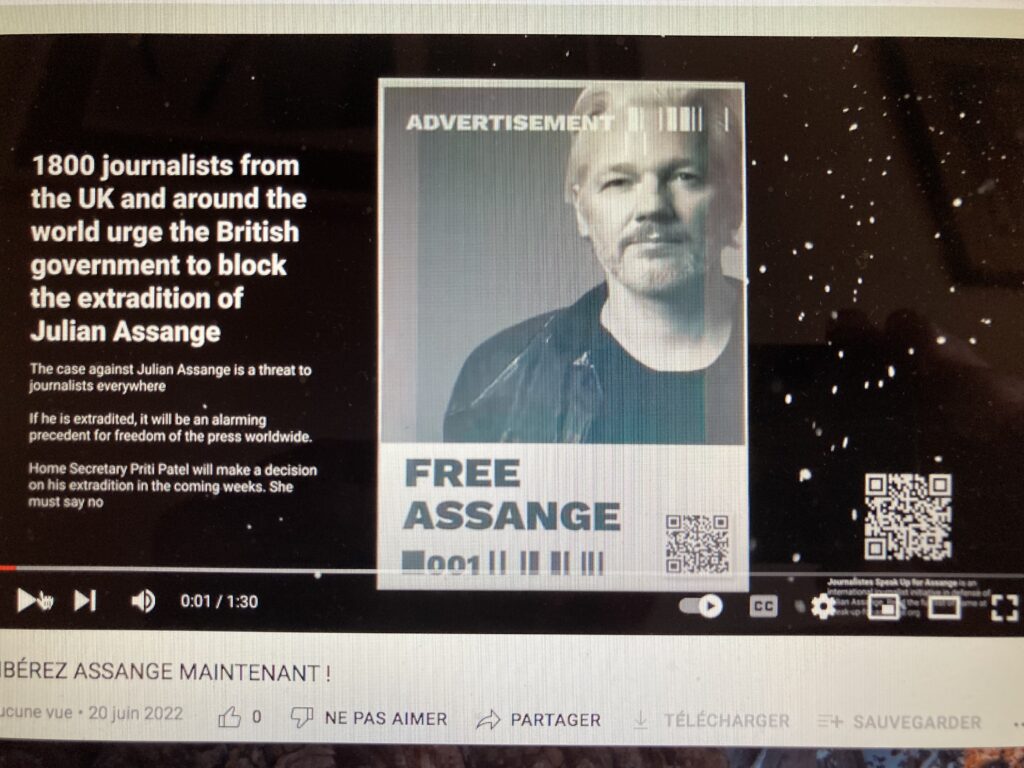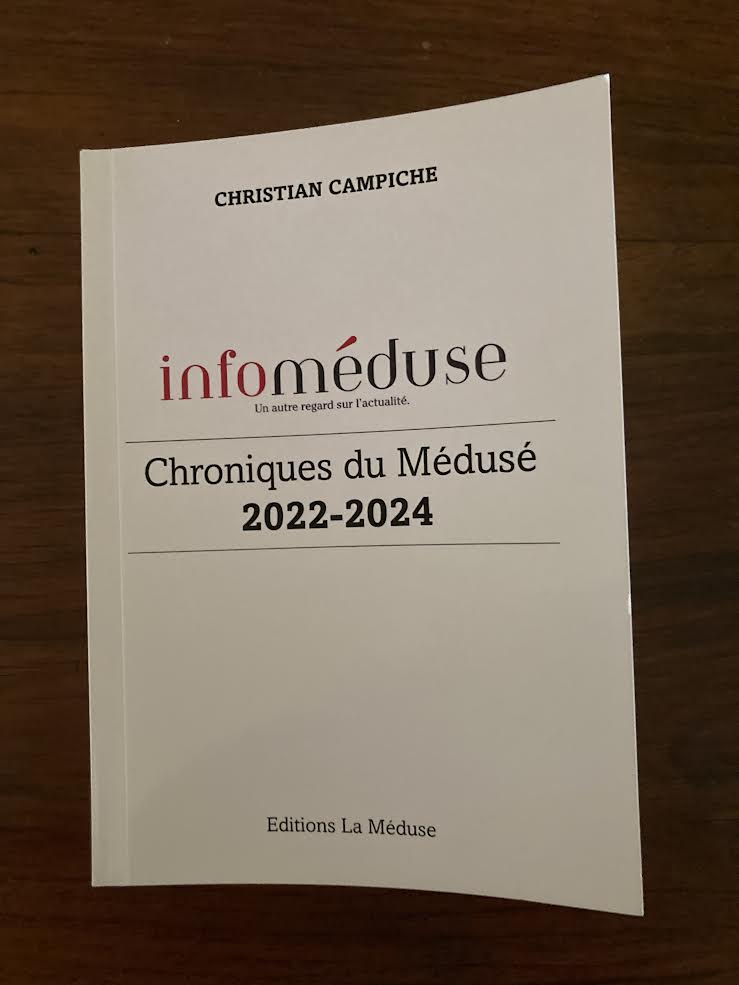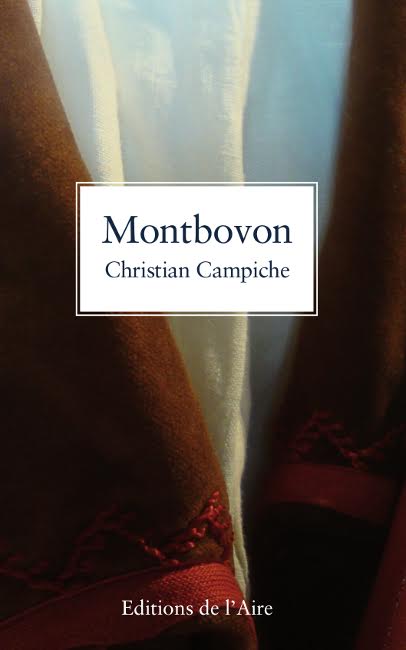Dans le poulailler de Paul Sautebin (photo), on ne trouve ni air conditionné, ni lumière artificielle.
PAR MICHAEL RODRIGUEZ
La ferme de Paul Sautebin, à La Ferrière, dans le Jura Bernois, contraste avec les grandes exploitations de la monoculture. Plutôt que d’avoir un grand troupeau de vaches pour la production linéaire de lait, ce paysan atypique, coprésident d’Uniterre Jura-Jura bernois, a misé sur la diversité, la complémentarité, les cycles naturels. «La ferme, c’est une espèce d’être humain, on y trouve plein de facettes de caractères», illustre -t-il. A côté des vaches, moutons, chèvres, ânes, chevaux et cochons, Paul Sautebin et sa compagne Isabelle élèvent aussi des poules, des oies et des canards. Leur poulailler, qui abritait cinquante poules il y a quelques années, n’en compte plus qu’une quinzaine. Le couple produit la quantité qu’il peut vendre à la ferme, pas plus. «Avant, on faisait des paniers de légumes, et on livrait les oeufs avec. On a arrêté: avec l’âge, on réduit un peu le travail.»
Mais petite quantité rime avec grande diversité. Entre la poule blanche suisse «de caractère dominant», l’Appenzelloise «curieuse de tout», l’Aurakana du Chili et la Marans, une poule française qui pond des oeufs bruns foncé, le seul point commun est qu’elles ne sont pas des hybrides. La plupart sont aussi des poules «à deux fins», c’est-à-dire qu’elles sont bonnes à la fois pour les oeufs et pour la chair.
Dans le poulailler de Paul Sautebin, on ne trouve ni air conditionné, ni lumière artificielle. Les poules couvent elles-mêmes les oeufs servant à la reproduction. Les meilleures couveuses, Paul Sautebin ne les tue pas et les laisse «mourir de leur belle mort». Certaines de ses poules ont même vécu jusqu’à près de quinze ans. Un âge canonique, quand on sait qu’un poulet d’élevage standard est tué après 30 à 45 jours, et une pondeuse après 12 à 18 mois!
Comment êtes-vous devenu paysan?
Paul Sautebin: J’ai grandi dans une ferme, mais je n’avais pas la personnalité pour reprendre l’exploitation familiale. J’ai dû faire horloger, et j’ai bossé 35 ans dans l’industrie et la bijouterie. Entre 1975 et 1985, le secteur s’est effondré, on est passé de 100’000 à 22’000 emplois. Et comme j’étais très militant, j’étais réprimé. Vers l’âge de 42 ans, j’ai décidé de me retourner et de faire quelque chose qui correspondait mieux à mes aspirations. Je voulais créer une ferme pédagogique. Cette idée venait de ma propre enfance. Pendant mes neuf années de scolarité, j’ai surtout fait l’école buissonnière, je n’étais pas du tout intégré et je n’arrivais pas à apprendre. J’ai donc fait une ferme pédagogique avec deux ânes, deux vaches, des moutons, etc. On recevait des classes d’école et on faisait jusqu’à trente camps par année. Il nous arrivait de partir une semaine avec des ados, on prenait tous les animaux y compris les cochons et on dormait dans la forêt. J’ai fait ça pendant quinze ans.
En quoi les poules se prêtent-elles bien à l’élevage?
La poule produit 98% des oeufs consommés sur la terre! C’est un oiseau extraordinaire qui, même à l’état sauvage, pond beaucoup d’oeufs. Les poules ont un territoire bien défini, elles vivent en groupes. Omnivores, elle se nourrissent au sol car elles ne volent pas. On peut donc les lâcher sur le territoire de la ferme et elles vont picorer leur nourriture sur le fumier, ou dans les déchets du moulin. Elles rentrent toutes seules au poulailler, au coucher du soleil. Ce sont des animaux qui ont été domestiqués bien avant l’invention du treillis! Les poules se reproduisent aussi à grande vitesse. On en a ici qui font trois couvées par année. Elles vont même couver les oeufs d’autres poules, d’oies ou de canes. Ce sont des stratégies de survie de l’espèce qu’on peut utiliser. Les poules s’intégraient donc bien dans l’économie d’une ferme. Il y a une cinquantaine d’années, on trouvait encore beaucoup de Leghorn (1) dans la région, des poules à deux fins. Aujourd’hui, avec la séparation industrielle des filières et la hausse de la consommation, près de cent millions de poules servent chaque année, ici ou à l’étranger, à produire la quantité nécessaire aux besoins de la Suisse!
Serait-il possible de se passer des poules hybrides?
S’il s’agit de satisfaire la consommation actuelle du pays, je pense que non. Les ressources en fourrages et en génétique ne sont pas suffisantes. Depuis l’affaire des lasagnes au cheval, on dit qu’il faut «produire suisse». Mais il y a beaucoup de démagogie dans ce discours. On n’a pas le cadre pour produire pour 8 millions d’habitants.
Du moins à ce niveau de consommation…
Oui. Et à ce niveau de gaspillage! Selon les chiffres officiels de la Confédération, 30 à 40% de la nourriture se perd du champ à l’assiette. La moyenne dans les pays occidentaux est encore plus élevée, 50%. Il y a du lait, de la viande qui partent à la poubelle. Le système de sélection animale produit aussi des déchets. Beaucoup de veaux sont éliminés: on ne veut pas les mâles des races laitières car ils ne s’engraissent pas facilement. Après dix mois de ponte, la plupart des poules hybrides sont brûlées. Je ne sais pas si ce gaspillage est compris dans les calculs officiels. C’est le problème de l’agriculture intensive: on cherche à produire le meilleur marché possible, mais comme c’est un système vorace en énergie, on importe l’énergie à bon prix sur le dos des autres. Ce n’est pas visible ici, mais ça l’est pour les paysans qui perdent leur terre en Argentine parce que on veut y cultiver du soja pour l’élevage.
Les rares éleveurs qui tentent de travailler avec des poules fermières ont de la peine à s’en sortir. Pourquoi?
Les anciennes races sont menacées, même celles qui sont de bonnes pondeuses. En effet, le prix des oeufs produits avec des hybrides est beaucoup plus bas. Les poules de race sont fragiles, parce qu’elles sont entretenues par des éleveurs qui le font à très petite échelle, avec des lignées étroites. Par contre, en les croisant, on obtient des poules plus résistantes. Mes meilleures poules sont celles qui sont nées de croisements à la ferme. Je pense donc que c’est possible de faire de la production sans hybrides. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de la spécialisation.
De votre côté, comment vous en sortez-vous?
L’an dernier, on a vendu pour 3000 francs d’oeufs et de poules, et dépensé 1200 francs pour les aliments. Mais il faut voir que la ferme, c’est un ensemble. On a aussi trois vaches, deux chevaux, six chèvres et six brebis. On vend du fromage, des céréales, des légumes, un peu de bois, tout en vente directe à la ferme. Avec 40’000 francs par année, on vit super bien. On a même presque fini de payer la maison! Bien sûr, c’est un mode de vie différent. On fait nos rénovations nous-mêmes. Et les vacances, on les passe avec les vaches…
Le problème, aujourd’hui, c’est que le marché entre dans tous les aspects de la vie de la ferme, parce qu’il y a partout des petites aspérités où gagner de l’argent. L’industrie pénètre dans la ferme pour tout manger et pour exclure tout ce qui est gratuit. Si vous avez des poules ou des lapins, alors vous irez acheter vos aliments chez Landi… Ici, on ne donne que du pain sec et du foin aux lapins. Les poules, on les nourrit avec du son, de l’épeautre et de l’ortie séchée. On doit juste acheter des granules bio pour les protéines.
On prend aussi des cochons, mais seulement quand on a du petit-lait de nos chèvres. Au début, quand ils sont tout petits, on achète juste pour cinquante francs d’aliments pour deux animaux. Ensuite, on leur donne du son de nos champs, de l’herbe et du petit-lait. Un cochon peut nous laisser jusqu’à mille francs de revenus. Un jour, on a voulu offrir du petit-lait à des voisins qui ont des porcs mais ils ont refusé: ils produisent pour Coop et n’ont pas le droit de choisir la nourriture de leurs animaux! Dans la vision de l’agro-écologie, la ferme est un cycle. Mais le marché n’aime pas cela, parce que ce sont autant de travaux qui lui échappent!
Pourquoi n’y a-t-il pas davantage de paysans qui sortent du système intensif?
Le management est partout dans l’agriculture. Les paysans se spécialisent à fond, par exemple dans le lait, et ils ne s’en sortent pas. Ils pourraient gagner de l’argent autrement, mais culturellement, c’est difficile de changer les mentalités. Les paysans se sentent plus sûrs en tracteur, ils ont l’impression d’exister quand ils sont assis sur un «John Deer». Même Bio Suisse, c’est du management. Je les ai contactés dernièrement pour une table ronde que nous organisons à Uniterre sur la libéralisation du marché du lait. Il nous fallait un traducteur pour trente minutes. Même ça, ce n’était pas possible, la personne m’a répondu que c’était incompatible avec sa fonction à Bio Suisse! Ils ont la trouille parce qu’ils négocient sur l’ouverture du marché du lait.
Quels sont les leviers pour tenter de faire bouger les choses?
Depuis les deux guerres mondiales, le secteur primaire est devenu secondaire. On a mis l’agriculture dans un état de dépendance vis-à-vis de l’industrie, et les paysans dans la dépression. Malgré cela, il reste encore pas mal de petits paysans en Suisse. Ces derniers fournissent par exemple 80% de la production de lait. Il y a donc encore quelque chose à sauver.
D’autre part, la Suisse applique des règles qui limitent l’intrusion du marché dans la production. Je pense notamment aux compensations écologiques et à l’obligation de sortir les vaches à l’air libre. J’y vois comme une sorte de souveraineté alimentaire diluée. Il faut utiliser ces acquis pour les développer. A Uniterre, nous nous battons pour la souveraineté alimentaire, mais cela ne peut pas être réalisé par le haut. Il faut travailler avec les paysans pour trouver des portes de sortie. L’UDC est en train de faire une campagne culturelle chez les paysans pour leur dire de produire plus. C’est en totale opposition avec la souveraineté alimentaire, qui vise à travailler avec les cycles de la nature.
(1) Race d’origine italienne, développée aux Etats-Unis, et qui a servi de base génétique aux pondeuses hybrides actuelles.
Cet article est le sixième d’une série écrite par Michaël Rodriguez. Paru dans «Courant d’Idées», il fait partie d’une brochure, « Faut-il abandonner la poule à l’industrie? », 47 pp, 9 francs. Celle-ci peut être commandée auprès de M. Reto Cadotsch, 9 quai Capo d’Istria, 1205 Genève, raeto.cadotsch@wanadoo.fr.